Le Cinéma de Philippe de Broca
1959. Les Jeux de l’Amour révèlent la personnalité iconoclaste de Philippe de Broca, ancien assistant de François Truffaut et Claude Chabrol, l’un des rares metteurs en scène issus de la Nouvelle Vague à emprunter les sentiers de la comédie. Le film est mis en musique par un jeune compositeur de trente-quatre ans, dont la signature a déjà accompagné une quarantaine de courts-métrages. Avec Les Jeux de l’Amour, Georges Delerue sera le premier musicien de Philippe de Broca, de Broca le premier réalisateur à lui confier l’intégralité d’une partition pour un long-métrage, avant même Truffaut, Cavalier ou Malle. S’en suivront dix-sept films étalés sur trente ans : à l’heure des comptes, Philippe de Broca est le cinéaste pour lequel Delerue aura le plus noirci de papier à musique.
Philippe de Broca raconte Georges Delerue : 1959-1968

En 1959, à vingt-six ans, je me préparais à tourner mon premier long-métrage, Les Jeux de l’Amour, et je cherchais un compositeur. Par hasard, je suis tombé sur un film publicitaire Maggi où des vaches (folles ?) dansaient sur un rythme de french-cancan ! Je me suis dit : “Voilà ce qu’il me faut : c’est vif, enlevé et tonitruant !” Henri Colpi, réalisateur de cette pub, m’a précisé qu’il s’agissait d’un jeune garçon très prometteur, Georges Delerue. Pas de bol : il avait déserté Paris pour des vacances dans le Midi. J’ai bondi dans un train pour le traquer dans sa villégiature, à Saint-Jeannet. Je revois sa petite bicoque provençale, en location, mais avec un piano. Il m’a ouvert la porte : je faisais tellement jeune qu’il m’a pris pour un coursier ! (rires) On a parlé du film, je lui ai dit deux ou trois mots du sujet, en évoquant la possibilité d’une valse pour le générique. Il s’est aussitôt mis au piano : “Une valse comme celle-là ?” Ca y est, il avait trouvé : sa valse avait quelque chose de guilleret, d’élégant, avec un arrière-goût de tristesse. A partir de ce jour, j’ai été incapable de me passer de Georges, de l’homme et du compositeur.
Pourquoi une valse ? Je l’ignore… A vingt-six ans, j’étais déjà un vieux con, totalement en dehors du coup ! (rires) Comme je me méfie terriblement de la mode, j’essaye de m’appuyer sur des références durables. En plus, quand vous avez un compositeur comme Delerue, vous ne lui demandez pas du disco ou du hard-rock ! Mais, c’est vrai, Georges s’accordait à trouver des connivences entre mon univers et la valse : un mouvement perpétuel, une ronde des sentiments où rien n’accroche, où tout se détache… Beaucoup de thèmes qu’il m’a composés sont bâtis sur des rythmes à trois temps : Le Roi de Cœur, Les Tribulations d’un Chinois en Chine… sans parler de mes trois premiers films, interprétés par Jean-Pierre Cassel : Les Jeux de l’Amour, Le Farceur et L’Amant de Cinq jours. Puis est arrivé Cartouche, qui m’a été proposé par les producteurs Alexandre Mnouchkine et Georges Dancigers des Films Ariane. Cartouche a marqué une vraie transition dans ma carrière : je passais de marivaudages Nouvelle Vague en noir et blanc à un cinéma-spectacle, historique, d’aventures. Et là, j’ai dû batailler ferme contre Mnouchkine qui me suggérait fortement Georges Van Parys ou Paul Misraki. Deux vétérans contre un jeunot qui, à l’époque, n’avait pas encore fait ses preuves dans le registre épique. J’ai fini par avoir gain de cause, à l’usure. Delerue a merveilleusement réussi la partition de Cartouche et, à partir de là, Mnouchkine n’a plus juré que par lui.
Physiquement, Delerue avait un côté un peu cassé, avec une grande tête, au visage très expressif. Il venait du Nord et ressemblait aux paysans flamands de Bruegel. Ses origines modestes ne rendaient pas pour autant son comportement “populaire”. Au contraire, Georges était simple mais bien élevé et très chaleureux. Il y avait chez lui une grâce qui me touchait beaucoup. Alexandre Mnouchkine disait souvent : “Delerue est l’homme le plus heureux que j’aie rencontré !” Il avait raison : Georges aimait profiter de sa famille, de la musique, de la bonne chère, sans se compliquer l’existence. Parti de rien, il savait apprécier ce qui lui arrivait, un certain confort apporté par la réussite. Il prenait vraiment la vie au premier degré. Je ne l’ai jamais entendu disserter sur son travail, l’expliquer, l’analyser. Plutôt que de pérorer sur la musique, Georges préférait en écrire.
Quand j’ai démarré, on était en pleine époque des Branquignols, dont les spectacles étaient mis en musique par un compositeur que Delerue respectait beaucoup, Gérard Calvi. C’étaient des films comiques avec des musiques comiques, d’un burlesque totalement assumé. Moi j’adorais ça… mais pas pour moi. Car, à mes yeux, la comédie est basée sur une façon drôle de voir des choses graves. Georges comprenait pleinement cette démarche : il mettait dans mes films tout ce que je ne parvenais pas à y mettre moi-même, sans doute par pudeur. Pourtant, j’ai longtemps rêvé de raconter des histoires tragiques… mais l’humour ou la dérision m’ont presque toujours rattrapé, détourné, pris en otage. Heureusement, mon Georges était là pour me ramener vers la gravité. Car voilà son génie : rendre palpable, derrière un vernis de légèreté, une insondable tristesse, une impression de la fragilité des êtres et des choses, que tout est perdu ou va se perdre… Le regard et l’apport de Delerue, c’était tout ce que je n’osais pas exprimer, tout ce que j’avais retenu au scénario ou au tournage. Pour caricaturer, j’étais la désinvolture, la superficialité, il était la profondeur. Dans une comédie comme Le Diable par la Queue, sa musique apporte une époustouflante dimension de tendresse, de nostalgie… à travers une valse lente, pour piano et cordes, que joue à l’image le personnage de Jeanne (Clotilde Joanno). C’est à cause de ce thème que Yves Montand s’éprend d’elle : brusquement, il cesse de faire le clown et lui raconte sa vie d’escroc minable. Quand une femme vous joue cette valse, vous ne pouvez que tomber amoureux ! Ce thème de Jeanne, c’est peut-être l’une de mes compositions préférées de Georges… Je voudrais qu’on le joue à ma messe d’enterrement ! (rires)
Dans Le Diable, j’aime également le générique début, un habile détournement de musique de cour. On devrait l’entendre sur les grandes eaux à Versailles… Or, à l’image, on voit un château décrépi, dont le toit pisse comme une vache, obligeant Jean Rochefort à jongler avec les pots de chambre. C’est une autre façon de concevoir les grandes eaux ! Par effet de décalage, la musique décuple le dérisoire de cette famille d’aristos décavés dans leur manoir miteux… J’ai aussi en tête, dans L’Homme de Rio ou Les Tribulations d’un Chinois en Chine, une musique qui n’hésite pas à jouer le jeu du suspense ou de la poursuite. Quand on fait de la caricature, il faut y croire. Sinon, on tombe dans la parodie ricanante. La musique de Delerue fait comprendre que nos méchants de convention sont quand même des méchants. Bien sûr, on rit mais il faut malgré tout avoir peur. Dans Le Chinois en Chine, j’aime bien le thème générique, un savoureux croisement entre la valse française et les mystères de l’Asie… Pour être franc, je préfère la musique au film ! (rires) Je sais que les enfants l’ont adoré mais c’est un pastiche outré, un super-Barnum caricatural : trop de pirouettes, trop d’extravagances, trop de fantaisie appuyée. Ma singularité, ce ne sont pas les cascades et le gros comique. C’est plutôt une manière funambulesque de traiter les choses… Par réaction, l’année suivante, j’ai tourné Le Roi de Cœur, une farce tragique, totalement baroque : l’histoire d’une petite ville du Nord, pendant 14-18, désertée par ses habitants mais envahie par les fous de l’asile… Le film été un bide noir… Peut-être l’ai-je un peu raté… En tout cas, j’avais demandé à Georges de jeter une oreille du côté de la musique expressionniste, de Kurt Weill. Il m’a pondu une belle valse fragile, déglinguée, qui part en dissonances. Comme une boîte à musique qui ne tourne pas rond… C’est un mélange de fêlure, de nostalgie, de petit manège intérieur…
Depuis des années, je n’écris pas un scénario sans écouter carrément la Messe en si de Bach ou une symphonie de Beethoven. D’un point de vue dramaturgique, leur structure me fascine. J’aime comment Beethoven expose discrètement le thème au début de la symphonie, l’escamote, le fait revenir, le développe en mineur ou majeur, en andante ou presto. En termes de construction, j’apprends énormément de Bach ou Beethoven… Au cinéma, la musique m’aide aussi à la structure. L’apport de Georges était autant musical que scénaristique. A ce titre, la fin de Cartouche est exemplaire : Vénus (Claude Cardinale) vient de mourir, Cartouche met son corps dans un carrosse qu’il pousse, la nuit, dans un lac… Sur les images du carrosse d’or qui s’enfonce dans les eaux noires, Georges reprend à l’orchestre le thème de Vénus et Cartouche mais en mineur, sur un rythme de marche lente, quasi-funèbre… Comme une évocation du temps du bonheur, une manière d’intensifier le souvenir de Vénus dans la mémoire de Cartouche. C’est terriblement vibrant, ça vous fait monter les larmes…
En réécoutant toutes ces musiques, ce sont aussi des images de Georges en studio qui me reviennent en tête : Davout, bien sûr, mais aussi la salle Wagram, qui servait le week-end de salle de boxe. Delerue s’enthousiasmait « L’acoustique est vraiment formidable ! » alors qu’il dirigeait depuis un ring ! (rires) Je profitais de ces séances pour observer le monde des musiciens qui m’a toujours fasciné : ils jouaient du Delerue en état de grâce, dans la beauté de leur art. Mais dès la fin de la prise, ils se mettaient à jacasser du tiercé, de la Sécu, de leur déjeuner : « Putain, le céleri rémoulade m’a foutu des aigreurs d’estomac ! » (rires) Moi, j’adore ça : le télescopage du sublime et du trivial. Parmi les solistes, toujours des musiciens de l’Opéra de Paris, j’avais repéré une petite vieille, toute cassée, derrière sa harpe : c’était la grande Lily Laskine. Georges l’adorait et l’employait quasi-systématiquement, même si elle finissait par avoir des problèmes de vue. Un jour, pour lui rendre hommage, j’ai apporté du champagne en studio. On a trinqué à la fin de la séance. Lily Laskine a bu quatre coupes, avant de repartir en titubant, me soufflant à l’oreille : « Je ne n’ai plus mes cordes pour me rattraper ! » (rires)
J’ai vraiment gardé un souvenir magique de ces enregistrements : je me déplaçais beaucoup, de la cabine à la salle, je me planquais dans un coin pour observer Georges agiter ses grands bras dans l’immensité du studio. Régulièrement, il se retournait vers moi, interrogateur : « Ça te va, Philippe ? » Là, j’avais le sentiment que tout était exclusivement organisé pour mon menu plaisir. Comme si Delerue était un artisan du Roi dont l’objectif suprême était de le contenter. Je suis très féodal, j’adorais cette situation ! (rires) Et puis, Georges mettait tellement d’énergie, d’implication à diriger ses musiciens, à leur faire sortir la musique qu’il avait en tête… Quand toute cette émotion, soulevée par un seul bonhomme, venait épouser mes petites images, j’avais la chair de poule. C’est toute la magie de la musique au cinéma : des effluves de lyrisme qui font s’envoler deux cabots qui se disent « Je t’aime » sur un écran de contrôle… Voilà pourquoi Delerue m’était si cher : parmi les ingrédients d’un film, sa musique exprimait plus que les autres les profondeurs de l’âme.
Philippe de Broca raconte Georges Delerue : 1969-1988
« Pendant dix ans, des Jeux de l’Amour aux Caprices de Marie, mes films ont été coécrits par Daniel Boulanger et mis en musique par Georges Delerue. Comme le résultat d’une symbiose à trois… J’étais au centre, encadré par deux auteurs qui intervenaient aux deux extrémités de la chaîne. Je trouvais –et je trouve toujours- qu’ils avaient plus de talent que moi ! (rires) Boulanger, en particulier, me fascinait et me terrorisait : je le trouvais intellectuellement plus original, plus inventif que moi-même. J’étais influencé par sa personnalité, par son sens du baroque, par ses trouvailles humoristiques ou poétiques. Trouvailles que j’acceptais car il me dominait. C’est tout le drame de ma vie : j’ai le sens de la grandeur mais sans avoir de génie. Il me faut des collaborateurs pour me tirer… Georges, lui, une fois le film tourné, me ramenait à l’essentiel, à ce que je voulais exprimer : la vie, avec ses drôleries, ses renoncements, ses petits désespoirs ou ses grands chagrins, le tout enveloppé de légèreté… car il s’agit d’abord de comédies, ce qui est de ma part une courtoisie ou une lâcheté.
Le début des années soixante-dix a marqué la fin de notre trio. Après Les Caprices de Marie, je ne travaillerai plus avec Boulanger… sauf pour Chouans !, en 1987, qui est l’aboutissement d’un vieux projet élaboré des années plus tôt. Quant à Georges, notre collaboration allait se poursuivre mais de manière plus discontinue. Curieusement, mon premier film sans Boulanger a aussi été mon premier film sans Georges : La Poudre d’Escampette, écrit par Jean-Loup Dabadie, en 1970. Après huit longs-métrages, je n’avais pas de scrupule à abandonner ponctuellement l’ami Delerue. C’était une infidélité, pas une trahison. De son côté, il travaillait sans arrêt, pour des tas d’autres metteurs en scène… Au départ, je croyais naïvement que nous aurions encore plus de plaisir à refaire équipe sur le film d’après… En réalité, c’est plutôt l’inverse qui s’est produit. Vous desserrez des liens que vous ne retrouvez plus à l’identique… Quand le trio s’est reformé pour Chouans !, il était déjà trop tard. Trop de temps avait passé… Je n’ai plus retravaillé avec Boulanger, que j’ai depuis complètement perdu de vue, je n’ai plus revu Georges qui nous a quittés quatre ans plus tard… Même si je suis orphelin des deux, je souffre moins de l’absence de Delerue : il n’est plus avec nous. Alors qu’il suffirait d’un coup de fil à Boulanger… (silence)

Pour en revenir à La Poudre d’Escampette, j’avais voulu confier la musique à Jean Wiener. Car il y avait une idée marrante à creuser : que mes trois personnages, perdus en Lybie en 1943, entendent de l’accordéon, du piano parisien, du jazz zazou au fin fond du désert… Et je voulais faire écrire cette musique par un compositeur historiquement lié à l’époque évoquée. Donc Jean Wiener. Mais ça s’est très mal passé, surtout à l’enregistrement : il n’avait rien préparé, il s’est mis à improviser au piano, pendant que son arrangeur besognait dans un coin… Le résultat ne ressemblait pas à grand-chose. J’étais catastrophé, Alexandre Mnouchkine encore plus. Wiener me donnait l’impression d’un monsieur très âgé, assez fatigué, pas impliqué. Ce qui n’enlevait rien au prestige de ses grandes partitions. Simplement, j’arrivais trop tard… J’ai été contraint de remercier Jean Wiener, qui a dû me détester, et d’appeler à la rescousse mon cher Delerue, pour tout reprendre à zéro. Et là, Georges m’a répondu : « Désolé, Philippe, je ne peux pas passer après Jean ! » C’était une belle preuve d’honnêteté : il aimait beaucoup Wiener, d’un point de vue musical, humain et politique. Avaient-ils été compagnons de cellule au PC ? Je l’ignore… (rires) Finalement, c’est Michel Legrand qui est venu à mon secours. Mais il me restera à vie le douloureux souvenir de cette séance avec Wiener… comme une espèce de punition à mon infidélité.
Du coup, Georges est revenu dès le film suivant, Chère Louise, avec Jeanne Moreau, un drame de la solitude signé Dabadie : l’histoire d’un amour impossible entre une vieille fille quadragénaire et un jeune homme. Je n’aime pas beaucoup le film, je lui préfère la musique, surtout le thème principal pour piano et cordes. J’en ai d’ailleurs abusé, je l’ai placé partout, sur des plans d’envols de cygnes sur le lac d’Annecy. Ca devient presque du formalisme… Avec Chère Louise, je n’étais pas dans mon univers. De toute façon, je suis moins à l’aise avec les sujets frontalement graves ou dramatiques. C’est aussi valable avec Chouans !, fresque sur les déchirements de la Révolution Française… Ma démarche est plutôt de raconter des histoires superficielles ou fantaisistes qui, au détour du chemin, lorgnent sur la tragédie. Et non l’inverse. Ce qui n’a pas empêché Delerue de réussir ses musiques pour mes films « sérieux ». La partition de Chouans ! ne manque ni de souffle, ni d’ampleur… Sur mes comédies, il était toujours d’une grande qualité d’inspiration, qu’elles soient ratées (Julie Pot-de-Colle), semi-réussies (L’Incorrigible) ou réussies (Tendre Poulet).
Il y a aussi Le Cavaleur, l’un de mes films préférés, où Rochefort incarne un pianiste concertiste qui court après ses femmes, après sa vie, après le temps qui passe. Là, Georges m’avait servi de conseiller musical en m’indiquant un concerto pour piano de Beethoven : « Tu verras, il correspond bien au mouvement du film et du personnage ! » Malgré tout, pour la dernière séquence, on a hésité entre le fameux concerto et une musique originale. En invoquant des raisons d’homogénéité, Delerue m’a convaincu de choisir… Beethoven ! Qu’il a lui-même spécialement arrangé et dirigé pour le film. Là au moins, il ne s’agissait pas d’une infidélité avec l’un de ses concurrents ! (rires) Le Cavaleur doit être le dernier film sur lequel on ait travaillé avant son exil américain… Gagnant de l’argent, un Oscar en poche, il est parti vivre à Los Angeles en 1981. Quelle évolution depuis le Delerue que j’avais connu en 1959, celui qui bouffait de la vache enragée et vivait dans un deux-pièces à Pigalle, pas loin du quartier à putes. Son piano occupait tout l’espace de l’appartement : le clavier dans la première pièce, la demi-queue dans la seconde ! (rires) Vingt ans plus tard, le voilà intronisé à Hollywood… C’était tout le paradoxe de Georges : un enfant de Roubaix, descendant de mineurs, compagnon de route du Parti Communiste qui se retrouve installé dans le symbole même du capitalisme américain. Où il vivait très heureux, d’ailleurs… Si j’avais réussi aux Etats-Unis, j’aurais peut-être fini comme lui, au bord d’une piscine californienne !
Entre Georges et moi, il n’y a pas eu de rupture, simplement un éloignement progressif. J’habitais Paris, lui Los Angeles… On avait chacun nos vies, séparées par quelques milliers de kilomètres… On s’est toutefois retrouvé sur deux films, L’Africain et Chouans !. Pour le premier, Georges était revenu en France : on a donc renoué avec nos vieilles habitudes. Car mon bonheur, c’était d’aller chez lui, près du lac d’Enghien, l’écouter me proposer des thèmes, dans son salon meublé faux Louis XIII. Là, je lui avais dit : « Je voudrais une ouverture qui coule comme un grand fleuve africain, vaste, boueux, irrémédiable… » Il s’est mis à son clavier et, déjà, je visualisais sa musique… En revanche, sur Chouans !, j’ai détesté la manière dont nous avons travaillé. Tout s’est passé entre Paris et Los Angeles, au téléphone : « Tiens, j’ai un thème, écoute ! » Et j’entendais dans l’écouteur un piano nasillard, venu de l’autre bout du monde, doublé par une voix cassée qui chantait faux. Eu égard à notre vieille complicité, je lui ai fait entièrement confiance, pour vraiment découvrir le résultat au studio Davout, à Paris, le jour de l’enregistrement. La musique était formidable… mais je n’ai pris aucun plaisir à sa conception. A partir de là, je n’ai plus contacté Georges pour mes films suivants. J’avais un chagrin d’amitié et besoin de lui, il était loin, je l’ai engueulé. Et puis, pour lui, composer pour un film français était un exercice particulier, presque une régression. Ca l’agaçait de devoir à nouveau travailler avec nos méthodes, nos moyens. Je pense qu’il avait l’impression de faire marche arrière… Dans son comportement, je devinais une certaine exaspération pour les musiciens français, leur côté « à la bonne franquette », sympas mais non disciplinés. Georges connaissait l’ultra-professionnalisme des orchestres hollywoodiens, le luxe des budgets musique alloués par la Fox ou la Paramount. Alors forcément… Quand vous vivez dans deux-cent mètres carré, vous avez du mal à revenir habiter votre vieille chambre de bonne, même si elle contient tous vos souvenirs de jeunesse. Chouans ! a donc été notre ultime rendez-vous : on a continué à se parler mais sans jamais se revoir.
Georges est parti en mars 1992. En pleine nuit, vers trois heures du matin, un journaliste radio m’a appelé pour m’interviewer. Quelle élégance : recueillir à brûle-pourpoint un sentiment sur un frère dont j’apprenais la mort… Quelques semaines plus tard, on m’a proposé d’organiser un feu d’artifice aux Vaux-de-Cernay, un château construit par les Rothschild au XIXème siècle, autour d’une abbaye romane. Pour rendre hommage à Georges, j’ai décidé de concevoir cette illumination avec et sur sa musique, en l’occurrence celle de Chouans ! et Dien Bien Phu, le film de mon ami Schoendoerffer, avec son fameux Concerto de l’Adieu. J’ai travaillé pendant un mois avec la maison Ruggieri, descendants de l’artificier de Louis XIV. C’est très compliqué : il y a un décalage à prévoir entre le lancement du feu et son explosion… Le tout sans perdre le synchronisme avec la musique. Le soir même, j’étais dans un état de tension et d’émotion extrêmes. La femme de Georges, Colette, était présente et j’ai bien l’impression qu’elle était en larmes, comme moi. Le feu d’artifice a commencé, l’assemblée s’est tue, captivée. J’ai enflammé l’abbaye, le château, la forêt. Tous ces feux partaient vers le ciel, là où Georges venait d’arriver. Il m’avait offert sa musique, je la renvoyais à travers les étoiles. Tout cela ressemblait à la vie et au cinéma : un spectacle éphémère et coûteux, nécessaire et inutile. Comme un mirage qui a existé le temps de quelques minutes… et dont ne subsiste que le souvenir chez les spectateurs présents ce soir-là. C’était un adieu, mon adieu, à Georges Delerue.
Stéphane Lerouge : Texte initialement paru dans les livret des CDs
Le Cinéma de Philippe De Broca 1959-1968
Le Cinéma de Philippe De Broca 1969-1988






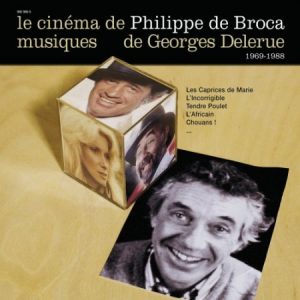



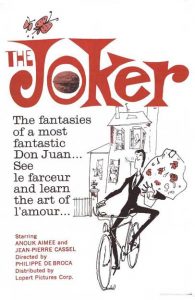




Comments ( 0 )